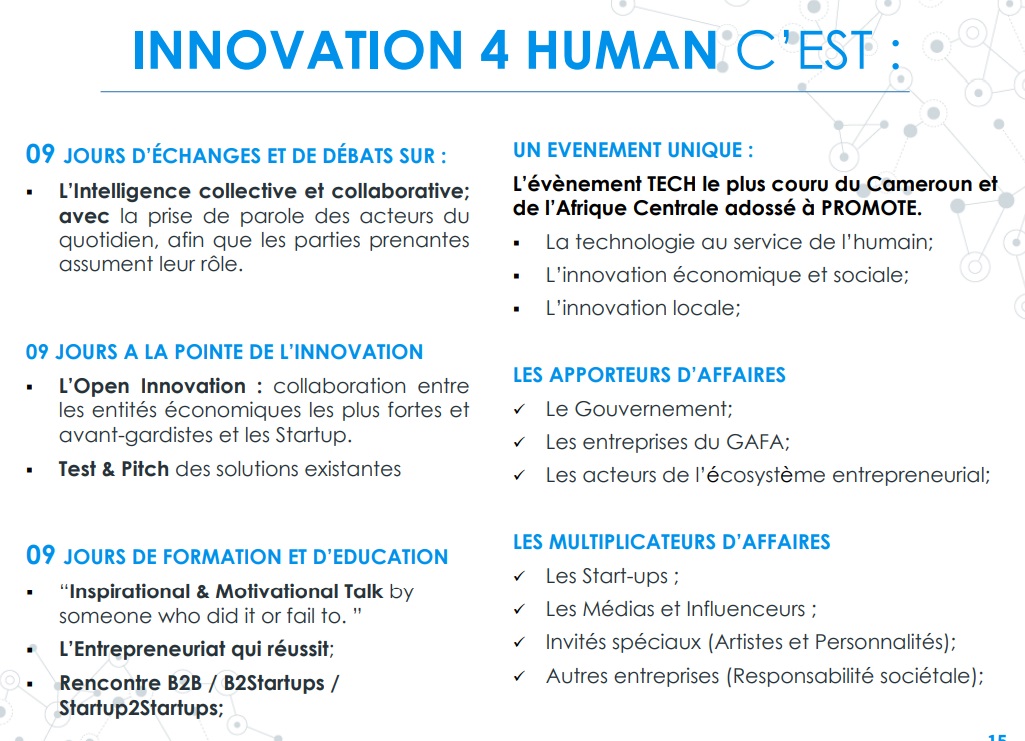[DIGITAL Business Africa] – On les appelle les OTT. Entendez, Over The Top. Ce sont les grands acteurs de l’économie numérique comme Facebook, WhatsApp, Viber ou encore Skype et Google qui offrent à leurs abonnés et utilisateurs les services d’appels voix et vidéos, ainsi que les services de messagerie. Aujourd’hui, Papa Gorgui Touré, DG de Tactikom et créateur du simulateur COST-EC, les appelle les OVNO : Offshore Virtual Network Operator. Comment facturer ces opérateurs virtuels qui n’ont pas de réseaux dans les pays africains, mais qui grignotent des parts importantes dans les revenus des opérateurs télécoms, qui, eux ont investi pour mettre en place leurs réseaux utilisés gratuitement par ces “OVNO”? Dans cet entretien avec DIGITAL Business Africa, Papa Gorgui Touré propose des pistes de solutions à cette problématique mondiale.
Digital Business Africa : Avec l’apparition des OTT, ils sont rares les pays Africains à avoir trouvé un modèle pour taxer les OTT comme WhatsApp, Facebook ou encore Viber. D’autres se demandent même s’il est nécessaire de les taxer. Comment analysez-vous cet embarras des pays africains ?
Papa Gorgui TOURE : La régulation ne se fait pas avec des prix, elle se fait par la connaissance des coûts. Les modèles du début des années 2000 qui ont été utilisés par la majorité des régulateurs africains sont tombés en obsolescence dès que les applications de l’Internet ont cessé d’être Over The Top (OTT) pour devenir de véritables offres concurrentes au cœur des réseaux. Tout le monde a été surpris par la fulgurance du changement.
Digital Business Africa : Aujourd’hui, les opérateurs mobiles voient leurs revenus VOIX baisser au fil des ans à cause de ces « OTT » qui grignotent des parts importantes de leur chiffre d’affaires. Quel est l’ampleur de ce phénomène à vos yeux ?
PGT : Vous savez qu’il y a encore quelques années les communications vocales internationales en TDM (VoTDM) représentaient plus de 50% des revenus des opérateurs. La VoIP s’est substituée à la VoTDM de sorte que cette dernière, dans certains pays représente à peine 4% de l’utilisation de la bande passante internationale, les 96% étant partagés par les applications IP « faussement gratuites ». Naturellement cela induit les baissent dramatiques de chiffre d’affaires constatées sur tout le continent africain en particulier.
Digital Business Africa : On imagine mal un petit opérateur d’un pays africain affrontant les WhatsApp, Facebook, Viber, Microsoft, Google et d’autres pour revendiquer ses droits. Comment faut-il aborder le sujet ?
PGT : Les éditeurs de contenus ne sont pas des ennemis. Par leurs initiatives ils ont ajouté de la valeur au secteur de la communication électronique en valorisant ces contenus comme jamais auparavant. La majorité des services qu’ils offrent sont en dehors du périmètre des marchés pertinents et n’ont que des impacts positifs pour les opérateurs réels avec l’accroissement du trafic qu’ils provoquent. C’est uniquement leur statut d’OVNO (Offshore Virtual Network Operator ), qu’ils ont acquis en entrant dans les marchés pertinents soumis à règlementation sans accord avec leurs partenaires techniques locaux sur les applications concernées, qui doit être correctement intégré dans leurs modèles d’affaires pour que tous les acteurs soient correctement rémunérés.
Il est normal que les OVNO fassent tout pour conserver la situation de rente acquise en prenant par surprise les opérateurs, les régulateurs et les autorités administratives ; mais ils savent pertinemment que les opérateurs ne peuvent pas continuer à investir à perte, pour que eux fassent les bénéfices que tout le monde connaît.
Digital Business Africa : Techniquement, comment démontrer ce statut d’OVNO et pourquoi personne ou très peu de personnes n’y ont pensé jusqu’ici ?
PGT : Il importe d’expliquer sans trop entrer dans les détails techniques, tant sur le plan national que sur celui international, que les OVNO, vis-à-vis du marché pertinent national, ne sont plus au niveau 7 de l’architecture en couche dite OSI (Open System Interconnection) pour justifier l’appellation ancienne OTT (Over The Top) donnée à leurs applications, mais bien au niveau 3 (qui est le niveau réseau) et qu’à ce titre ils sont des acteurs au niveau national comme le sont les MNO (Mobile Network Operator ) et les MVNO (Mobile Virtual Network Operator ) par exemple. Sauf qu’eux sont « Offshore » et à ce titre ne sont soumis à aucune règle nationale. Mais, au-delà de ces considérations techniques, le plus simple est de les comparer aux MVNO :
| Caractéristiques |
MVNO |
OVNO |
| Possède son propre réseau d’accès aux clients |
NON |
NON |
| Peut exploiter des nœuds de réseau |
OUI |
OUI |
| Offre des services, donc génère des besoins en investissement, sur le réseau du MNO dont il a accès aux abonnés |
OUI |
OUI |
| Perçoit directement les paiements des consommateurs |
OUI
(En espèces) |
OUI
(En nature) |
| Passe un accord avec le MNO en question dans le but de défrayer celui-ci de ses frais d’amortissement, d’exploitation et de gestion |
OUI |
NON |
| Est soumis, comme les MNO, à la régulation nationale |
OUI |
NON |
Pourquoi personne ou très peu de personnes n’y ont pensé ? Le marché a été surpris par la rapidité du changement qui a accompagné l’augmentation des débits numériques avec le 3G puis la 4G. Mais, il était possible de prévoir cela sur le long terme, certains l’on fait.
Digital Business Africa : Pour vous, les OVNO, à l’instar des MVNO, doivent payer un prix de gros aux opérateurs télécoms réels, car ce ne sont pas les clients qui payent déjà (en nature certes) le prix qui leur est demandé par les OVNO. Comment ce paiement-là pourrait-il se concrétiser ?
PGT : Les OVNO, à l’instar des MVNO, doivent payer un prix de gros aux opérateurs réels, ce n’est pas à leurs clients de le faire, car ces derniers payent en nature (toute leur informations privées) le prix qui leur est demandé par l’OVNO. Les informations personnelles des consommateurs sont revendues à prix d’or par les OVNO à ceux qui sont intéressés, preuve qu’elles ont une valeur immense. La « gratuité » est donc fausse. Si un MVNO voulait offrir ses services gratuitement dans un pays sur une offre relevant du marché pertinent, le Régulateur s’y opposerait au titre du plancher qu’est le « prix prédateur ». Pour ce qui est des mécanismes de règlement, il existe depuis très longtemps des accords internationaux de règlement de comptes, notamment au sein de l’UIT, que l’on pourrait dépoussiérer et adapter à l’échelle nationale. Des solutions seront trouvées le moment venu, mais le plus urgent est de bâtir rapidement le socle d’initiative africaine pour éviter la catastrophe annoncée.
Digital Business Africa : Aborder une question aussi importante à l’échelle africaine est sans doute une bonne démarche. Mais quelle doit être la contribution de chaque pays pour que l’argumentation globale soit irréfutable ?
PGT : Sachant qu’il pourrait s’agir d’une négociation difficile, chaque pays doit réaliser au niveau national une évaluation précise de ce que coutent aux opérateurs réels les services (dans le périmètre des marchés pertinents) offerts « gratuitement » sur leurs réseaux par les OVNO ; c’est la base du prix de gros sur lequel les opérateurs devront fonder leur négociation avec les OVNO, sous la supervision du Régulateur. Une préparation minutieuse est nécessaire : il ne s’agit pas, pour l’Afrique, de tendre la main pour demander de l’aide, il s’agit d’abord de quantifier l’évidence et de trouver, sur cette base, les moyens administratifs et techniques susceptibles d’amener les OVNO autour de la table de négociation.
Digital Business Africa : Vous l’avez dit, il y a des milliers d’applications sur le Net et elles ne représentent pas toutes le même intérêt pour les divers segments de nos populations. Comment faire le tri de ce qui doit être inclus dans la négociation avec les OVNO ?
PGT : Toutes les applications IP ne sont pas dans le marché pertinent. Celles qui doivent impérativement y être sont la VoIP, l’IM, sans doute le P2P et le Tunneling qui sont de potentielles applications de repli ; pour celles-là comme pour toutes les autres applications les opérateurs doivent pouvoir continuer à vendre des forfaits, mais comme le coût des services de ces applications aura au préalable été audités par le Régulateur, celui-ci pourra, de nouveau, exercer sa mission de contrôle de la conformité des offres préalablement à leur mise sur le marché. Il va de soi que des applications telles que la Voix (TDM), le Web _Browsing, le Streaming, l’Email et le Net_Storage n’auront pas le même coût au mégaoctet. Le Régulateur pourra, sur toutes ces applications, qui elles doivent être payées par le consommateur qui les utilise, exercer confortablement ses compétences.
Ce faisant, les opérateurs réels aussi, connaissant ce que leur coûte chacun des services offerts, y compris ceux des applications IP, retrouveront toutes leurs prérogatives en matière de marketing et de gestion, car sachant que le Régulateur est de nouveau en mesure de garantir le caractère loyal de la concurrence.
Digital Business Africa : Comment concrètement pourrait on préparer et conduire une telle négociation au niveau international ?
PGT : Aucun pays ne pouvant peser tout seul dans cette négociation, les régulateur et les pouvoirs publics doivent mobiliser sur le plan international tous les pays qui sont concernés par cette situation, peut-être par cercles concentriques, afin de trouver un accord avec les OVNO sur les paiements qu’ils doivent faire aux opérateurs réels. La première étape, c’est ce que vous faites : communiquer largement pour sensibiliser ceux qui ont le pouvoir de décider sur le caractère urgent et l’espoir que l’on place en eux. Les organisations politiques sous-régionales et régionales doivent se saisir de cette question sans créer de nouvelles structures.
Digital Business Africa : L’une des voix de sortie passe, d’après vous, par un plaidoyer important de la part des chefs d’Etat ou par l’ensemble des autorités politiques. Mais comment faire pour intéresser ces autorités politiques à la chose et inscrire cette problématique dans leurs agendas au niveau continental ?
PGT : Les Etats sont souverains et agiront en fonction de leurs intérêts. Mais, si une solution n’est pas trouvée à court terme, les opérateurs privés commenceront par licencier massivement pour rester à flot, mais cela ne suffira pas. Ils arrêteront les extensions de capacité sur les différents segments du réseau, ce qui provoquera un effondrement de la qualité du service ; ils ne seront pas en mesure de payer les amendes légitimes qui leur seront infligées en conséquence. Les opérateurs ne faisant plus de bénéfices, l’Etat sera privé des 10% à 15% du PIB en recettes directes, sans compter l’effondrement de toute une économie devenue très dépendante du numérique.
La seule alternative serait de laisser les opérateurs augmenter fortement le prix des forfaits pour faire payer aux consommateurs locaux ce que les OVNO ne payent pas. Ceci serait la cause, on le voit déjà, de mouvements sociaux violents pouvant affecter la stabilité des pays.
Propos recueillis par Beaugas Orain DJOYUM
 *Papa Gorgui TOURE est le Directeur Général de Tactikom. Il a développé le simulateur COST-EC qui est un progiciel expert capable de reproduire toutes les fonctions d’un ou plusieurs réseaux d’opérateur dans l’optique d’auditer le coût de revient de tout service offert sur toute application.
*Papa Gorgui TOURE est le Directeur Général de Tactikom. Il a développé le simulateur COST-EC qui est un progiciel expert capable de reproduire toutes les fonctions d’un ou plusieurs réseaux d’opérateur dans l’optique d’auditer le coût de revient de tout service offert sur toute application.
A la base ingénieur en électronique et électronique appliquée, avec une spécialisation en Télécommunication et informatique, Papa Gorgui TOURE a une expérience de terrain de plus de 25 ans. Il a mis son expérience au service du développement du réseau de télécommunications du Sénégal (successivement: Sous-directeur des centraux de commutation et des réseaux télématiques, chef du Département de l’Ingénierie, Directeur des Affaires Internationales et Directeur commercial, Directeur des Etudes et du Développement) suivis de sept ans en tant que fonctionnaire international à l’Union Internationale des Télécommunications (Genève) essentiellement en tant que Chef du Département des Politiques, des Stratégies et du Financement.