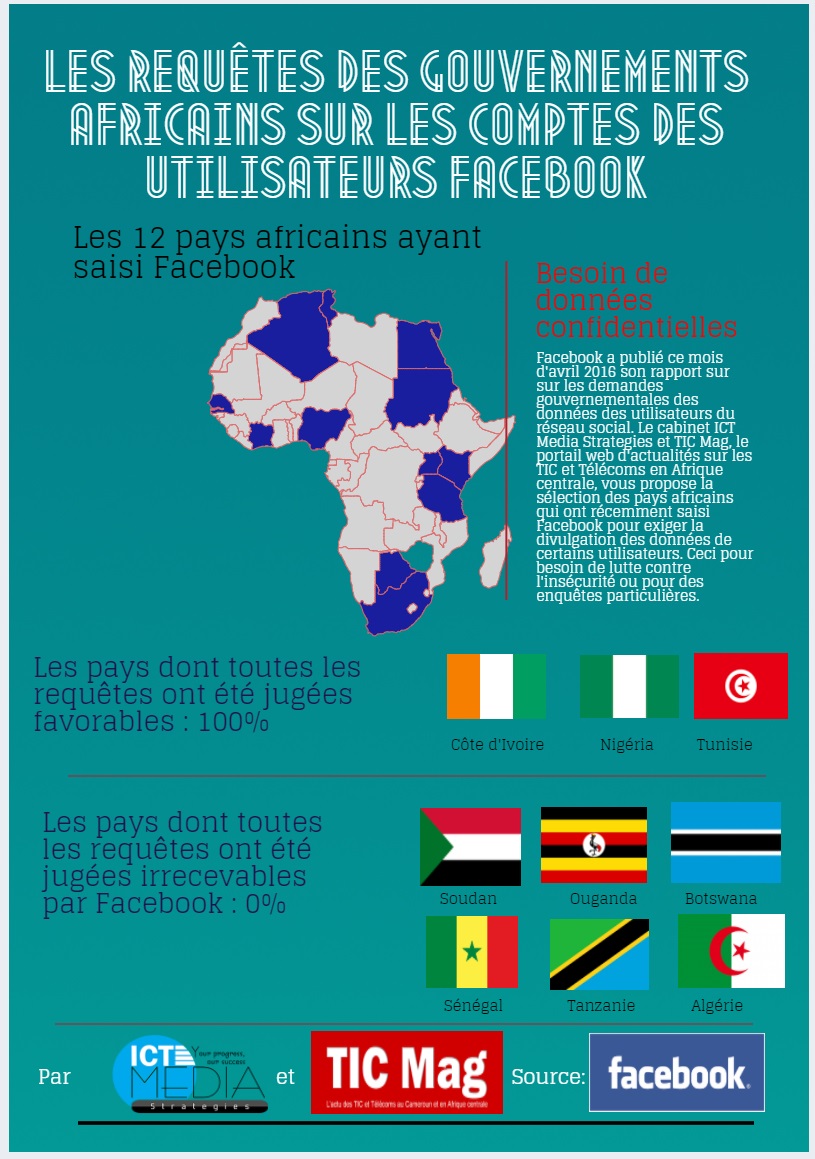(TIC Mag) – Le conseiller du président de la République du Gabon en matière de TIC explique à TIC Mag la stratégie et les orientations mises en place afin que le programme Gabon numérique cher au président de la République soit une réalité. Radwan Charafeddine fait partie de ceux-là qui constituent la matière grise d’Ali Bongo dans la mise en place d’une société de l’information et de la connaissance. Comment le Gabon est parvenu à avoir la place qui est aujourd’hui la sienne en Afrique centrale en matière des TIC ? Confidences de Radwan Charafeddine dans un entretien avec Beaugas-Orain DJOYUM. Le conseiller invite par ailleurs les investisseurs nationaux et étrangers du secteur des TIC et Télécoms à investir au Gabon. « Il y a tout à gagner », dit-il.
TIC Mag : L’on assiste aujourd’hui à un changement de la donne concernant les grands projets TIC du gouvernement. Le discours sur le projet de création de la Cybercity de l’île de Mandji par exemple a troqué sa place au discours sur le soutien des projets des jeunes innovateurs gabonais. Qu’est-ce qui explique ce changement de stratégie et cette volonté de se focaliser davantage sur les projets des jeunes gabonais ?
Radwan Charafeddine : Toute stratégie établie est menée à évoluer, afin de cadrer avec les réalités techniques ou économiques. Il faut savoir passer de la théorie à la pratique et certaines fois il faut avoir le courage de remettre en cause certains projets qui seraient trop ambitieux. La création de la Cyber City de l’île de Mandji aurait couté extrêmement cher, l’évaluation financière du projet nous a permis de le proroger, car non réalisable à court terme et sans un certain nombre de préalables. Les retombées économiques directes n’étaient pas satisfaisantes, car nécessitant un marché plus important et donc une meilleure intégration sous régionale du numérique qui est en cours de construction.
Il était donc nécessaire de réévaluer les priorités liées au secteur. Pour nous, la première de ces priorités concerne la jeunesse. Il ne peut avoir de progrès sans la jeunesse.
Le gouvernement gabonais construit des infrastructures numériques : ce sont de grandes autoroutes de l’information, et pour le moment les « voitures » qui circulent sur cette autoroute sont des voitures immatriculées à l’étranger. Je fais là une métaphore afin de comparer les voitures au contenu numérique et multimédia. L’Afrique, et le Gabon en particulier, a besoin de créer son propre contenu ! Et nous savons compter sur notre jeunesse créative. C’est pourquoi, nous devons nous orienter vers elle, pour lui donner la possibilité de s’exprimer, de se former aux dernières technologies afin d’être compétitif. Il faut stimuler cette émulation déjà existante dans l’entreprenariat gabonais pour créer ces contenus.
TIC Mag : Le projet de la Cyber City de l’île de Mandji était pourtant un grand projet qui intégrait les grands acteurs mondiaux de l’économie numérique…
R.C. : Oui. Mais aussi, un projet qui demandait un financement tellement important de la part de l’Etat. Ce n’était pas réalisable toute suite, mais peut être dans les années à venir. Dans le domaine des TICs, nous avons d’autres préalables à mettre en place. Et aujourd’hui, en plus de la mise à jour du cadre légal et réglementaire favorable investisseurs, de la création d’infrastructures numériques, je pense que se focaliser sur la jeunesse est l’un de ces préalables.
Il faut savoir construire étape par étape et former une élite gabonaise dans le domaine des technologies, des TICs, du développement d’applications, de l’ingénierie réseau, de la R&D, renforcer les programmes de formation existants, aider les startups et les autoentrepreneurs par des incubateurs. Tous ces points sont nécessaires pour accueillir les grands acteurs mondiaux. Sinon, ils ne feront qu’installer des serveurs qui importeront les contenus directement depuis l’étranger, sans jamais créer d’emplois.
TIC Mag : En clair, pour concrétiser le projet de Cybercity de l’île de Mandji, il faut déjà qu’il y ait cette jeunesse gabonaise bien formée. C’est bien cela ?
R.C. : Il faut qu’il y ait une émulation, il faut qu’il y ait un magma dans lequel les développeurs se sentent rassurés : techniquement et financièrement. Plusieurs entreprises et startups gabonaises existent, mais trop souvent elles sont biens seules, mal ou pas encadrées et ont tout le mal du monde à s’en sortir. Nous nous devons de les accompagner, pour qu’elles montrent l’exemple de la réussite gabonaise, de sa créativité et de son ouverture sur le monde. Vous savez, plus de 70% des Gabonais ont un accès à Internet, via leur smartphone. C’est le taux le plus élevé de la sous-région et cela démontre l’appétit de notre jeunesse vers le numérique. Il y a un potentiel énorme qui ne demande qu’à être exploiter. C’est pour cette raison que le gouvernement a lancé en partenariat avec la Banque mondiale, un projet de pépinière pour incuber les entreprises les plus créatrice. Trois incubateurs sont en cours de création : un à Libreville, un à Port Gentil et un à Franceville. Dans un premier, chaque pépinière pourra accueillir une dizaine d’incubés pendant trois ans, l’objectif étant d’atteindre le nombre de 60 par incubateur. De plus, il y a d’autres initiatives intéressantes qui ont des synergies avec le numérique et la création de contenus africains comme la création récente de l’African Music Institute (AMI) en partenariat avec la prestigieuse école Berklee College of Music de Boston.

TIC Mag : Le Gabon multiplie les partenariats avec les entités extérieures pour améliorer ou sécuriser ses services numériques. Prenons deux exemples : l’ANINF a signé avec le Russe Kaspersky, géant de l’antivirus informatique, pour la sécurisation des systèmes d’information et un transfert de compétences et avec Keynectics-Opentrust et Gemalto pour l’intégrité et la signature des courriers électroniques des administrations. Quels sont les garanties, les assurances et les mesures prises pour que ces opérateurs qui ont accès à ces informations publiques ne puissent pas les utiliser à d’autres fins ou que Keynectics-Opentrust et Gemalto n’accèdent pas aux courriers et données des administrations publiques ?
R.C. : La question est normale et a sa place. Mais, je ne pense pas que nous soyons le premier Etat à travailler avec ces entreprises. Beaucoup d’autres et même les multinationales internationales qui travaillent dans des domaines stratégiques comme le militaire et qui génèrent des centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires travaillent avec ces entreprises et cela se passe très bien. Affirmer que les fournisseurs d’antivirus ou de signatures électroniques de courriers peuvent accéder aux données est faux. Si cela avait été prouvé, je ne pense pas que ces sociétés, côtés en bourse, existeraient encore, car elles perdraient toute crédibilité et plus personne ne voudrait travailler avec elles.
Deuxièmement, techniquement il existe des méthodes très simples qui permettent de se prémunir de ce type de risque. Nos données sont cryptées en interne sur d’autres serveurs. Ce qui permet d’éviter la fuite d’informations. Nos données ne transitent aucunement par leurs serveurs, c’est le B A BA de la sécurité informatique.
Enfin, les données de l’Etat gabonais sont encore plus sécurisées depuis le déploiement du point d’échange gabonais et du réseau de l’administration gabonaise, car ces données ne transitent plus par les satellites étrangers ou par des serveurs à l’étranger qu’on ne maîtrise pas. L’ANINF a mis en place un data center qu’elle gère elle-même et l’ensemble des données restent désormais sur le territoire gabonais.
TIC Mag : Dans la zone Afrique centrale, on constate une forte mobilisation du Gabon sur la scène internationale à travers la participation aux salons internationaux sur les problématiques liées aux TIC et aux Télécommunications l’expérimentation ou le lancement des nouvelles technologies, etc. Pourtant, il y a des géants sous-régionaux comme le Cameroun ou la Guinée équatoriale. Que répondez-vous à ceux-là qui pensent que le Gabon veut ravir la vedette au Cameroun et en Afrique centrale ?
R.C. : Ecoutez, la compétition est bénéfique et est source d’améliorations. Donc, si vous considérez qu’on est en compétition, je pense que c’est une bonne chose. Pour ma part, nous sommes plutôt dans une optique où il faut faire en sorte que la sous-région bénéficie d’une qualité d’infrastructure numérique qui lui soit favorable, qu’elle soit de qualité, qu’elle soit encore plus compétitive grâce justement aux technologies de l’Information. La « mondialisation » nous oblige à avoir de meilleurs rendements, non pas uniquement avec les pays voisins, mais également avec les pays du monde entier : les Etats-Unis, le Brésil, la Chine, etc.
Aujourd’hui, dire que le Gabon est en concurrence avec le Cameroun ou avec la Guinée équatoriale, je ne pense pas que ce soit quelque chose que l’on peut affirmer. Mais, chercher à être leader ou chercher à faire en sorte qu’une sous-région soit compétitive dans le domaine du numérique et faire en sorte qu’on puisse avancer, oui, c’est notre objectif pour le Gabon.
Chaque pays doit avoir son secteur de spécialité. Le Gabon est un pays qui ne peut pas concurrencer le Cameroun dans certains domaines industriels à cause de la taille de notre marché, soit. Nous sommes obligés de chercher les domaines dans lesquels on peut exceller. Parmi ces domaines, il y a les Technologies de l’information et de la communication. Parce que c’est un domaine dans lequel même avec une faible population, on peut créer des applications qui ne seront pas uniquement à disposition des Gabonais, des Camerounais, des Congolais ou de la Guinée équatoriale ! Mais, du monde entier. Les barrières du marché mondial tombent et nous pouvons nous placer intelligemment.
TIC Mag : Dans cette volonté d’être leader, l’on constate une forte implication du président de la République, Ali Bongo, dans le secteur du numérique. Ses efforts ont d’ailleurs été récompensés en septembre 2015 par l’Union internationale des télécommunications qui lui a attribué le prix TIC pour le développement durable. Ce prix, d’après-vous, a-t-il davantage boosté les dirigeants gabonais du secteur du numérique dans cette volonté d’être leader dans le secteur du numérique ?
R.C. : Je pense que c’est une récompense qui a permis d’encourager le Gabon dans la voie qui est prise. Vous savez au Gabon, le gouvernement a lancé les réformes du cadre juridique et légal afin de mieux protéger les investisseurs et de mettre à jour les textes. Nous avons mis en place un point d’échange internet, Google y a déjà installé ses serveurs de cache, des projets de FTTH (Fiber to the home, la fibre optique à domicile) sont en cours d’étude avec des partenaires étrangers qui souhaitent investir dans notre pays. Les services à valeur ajoutée comme l’e-VISA, l’e-TAX ou encore l’e-Banking sont une réalité (Airtel Money, ou BGFI Mobile pour ne citer que ceux-là).
Nous faisons tout ce qu’il faut pour encourager la création de services à valeur ajoutée et pour qu’ils soient fournis à des coûts abordables. C’est quelque chose d’important. C’est pour cela qu’en deux ans nous avons divisé par trois le coût de l’accès à l’Internet au Gabon. Nous avons restructuré le marché et tout cela permet à l’abonné final, aux entreprises et PME de bénéficier des avantages de l’Internet. Cela permet d’être plus compétitif et les entreprises peuvent se développer plus facilement.
Nous mettons aussi en place une politique qui permet au secteur privé de venir s’installer au Gabon plus facilement. Nous avons mis en place un partenariat public-privé dans lequel l’Etat a dit écoutez : « Je mets en place les infrastructures, je vous les confie. C’est vous qui allez les commercialiser, les gérer et les maintenir ». Ceci pour nous assurer que ces infrastructures seront gérées et maintenues par des entreprises de classe internationale. Nous ne cherchons pas à garder tout en tant qu’Etat, nous cherchons à créer l’émulation, la compétition au sein même de notre pays pour faire en sorte que nous soyons les meilleurs.
TIC Mag : Parlons des pays qui s’intéressent davantage au Gabon dans le secteur des TIC. Le dernier pays qui a vraiment intéressé le Gabon à notre avis c’est l’Inde. A l’occasion du 3ème sommet Inde-Afrique qui s’est tenu du 26 au 29 octobre 2015 à New Delhi en Inde, l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf) a signé un accord préalable à un mémorandum d’entente avec l’Indian Centre For Social Transformation. Comment l’Inde peut-elle accompagner le Gabon numérique ?
R.C. : Je ne sais pas si vous connaissez vraiment l’Inde, mais moi j’y suis passé plusieurs fois notamment dans la ville de Bangalore qui est reconnue au niveau mondial pour son pôle Ingénierie, Informatique et Développement. Au moins la moitié des meilleurs développeurs d’applications dans le monde se trouvent en Inde ou en Chine. La majorité des applications des plus grandes entreprises comme Microsoft ou Google sont développées en Inde ou en Chine, même si les applications les plus stratégiques continuent très certainement à être développées aux Etats-Unis. C’est une expérience que les Indiens ont et qui est reconnue. Cette expérience de l’Inde, nous devons, en tant que pays qui cherche à devenir leader dans le domaine, être capable de l’exploiter. Et aujourd’hui, l’Inde cherche à partager cette expérience avec le Gabon. Nous avons tout à y gagner.
TIC Mag : D’où la volonté de nouer rapidement des relations avec eux ?
R.C. : C’est pour cela que nous avons signé des accords avec eux et je pense que cela permettra justement de mettre en place les canevas qui vont nous permettre d’avoir les bonnes structures pour la formation d’ingénieurs. Ce sont des choses qui sont actuellement en discussion et qui aboutiront très bientôt je l’espère.
TIC Mag : La maitrise des TIC et de ses différentes utilisations passe par une meilleure formation en TIC. Aux Etats-Unis par exemple, Barack Obama invite régulièrement les jeunes à étudier les mathématiques. Quelle politique est mise en place au Gabon en matière de formation dans le domaine des TIC et en matière de création des écoles spécialisées dans les domaines comme la cybersécurité où les compétences sont encore rares ?
R.C. : C’est vraiment aujourd’hui le défi à relever pour le Gabon dans ce que nous mettons en place : La spécialisation de notre capital humain dans des domaines choisis. Il n’y a pas que le domaine des technologies qui est concerné, mais tous les domaines techniques. Le choix a été fait dans un premier temps de créer des écoles spécialisées dans les mines, le bois, ou le pétrole. L’Institut africain d’informatique, qui a été créée avec nos voisins est actuellement en cours de restructuration et pourra relever le défi du développement d’applications. Dans la création de contenus musicaux et vidéo, l’AMI prendra le relais. Les pépinières seront là pour prendre le relais des projets les plus prometteurs. Donc, la chaîne est en train de se mettre en place, il a fallu tout réorganiser, je pense que nous commençons à voir le bout du tunnel. Soyons donc encore un petit peu patient !
TIC Mag : Quels sont aujourd’hui à votre avis les grands défis qui interpellent le Gabon en matière des TIC et Télécommunications ?
R.C. : Ils sont nombreux, car nous avons beaucoup d’ambitions pour notre pays. Vous savez, nous sommes encore loin de pouvoir réaliser tout ce que l’on voudrait. Ce qui est important, c’est de suivre le plan établi, pour avancer de manière structurée. Il n’est pas question pour nous de sauter des étapes.
Il faut un environnement des affaires favorable, il faut des infrastructures, il faut des universités et des écoles spécialisées pour notre une jeunesse qui est le socle de ce développement et des incubateurs pour les lancer et les guider. Heureusement, il y a une réelle volonté politique et nous atteindrons ces objectifs. Je ne vois pas aujourd’hui ce qui pourrait nous empêcher d’avancer. Et évidemment, nous devons être accompagnés par le secteur privé.
TIC Mag : Quels conseils donnez-vous justement à ces acteurs du secteur privé qui s’intéressent au secteur des TIC ?
R.C. : Les plus gros acteurs du domaine s’intéressent de plus en plus au Gabon. Des discussions avancées sont actuellement en cours. Le premier arrivé est le premier servi. Les opportunités sont belles et biens présentes et se dessinent, il suffit de regarder les indicateurs de la Banque mondiale qui sont dans le vert ! La conjoncture économique actuelle est surement difficile dans certains secteurs, mais ce qui est sûr c’est que le domaine des technologies de l’information fait désormais partie du quotidien des Gabonais ! il y a un marché qui a émergé et qui ne demande qu’à être exploité. Ce marché sera bientôt étendu à toute la sous-région CEMAC de par les autoroutes de l’informations qui sont déployées. On ne parle plus du marché gabonais de près de deux millions d’habitants, mais à plus de 50 millions d’habitant de la zone CEMAC ! L’avance en terme de gouvernance du numérique qui a été pris au Gabon, me permet de dire : « investissez dans le secteur des TIC. L’Etat est là pour vous accompagner et vous faciliter les choses, il y a tout à y gagner ».
Propos recueillis par Beaugas-Orain DJOYUM, à Libreville











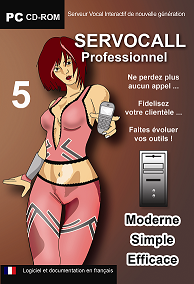



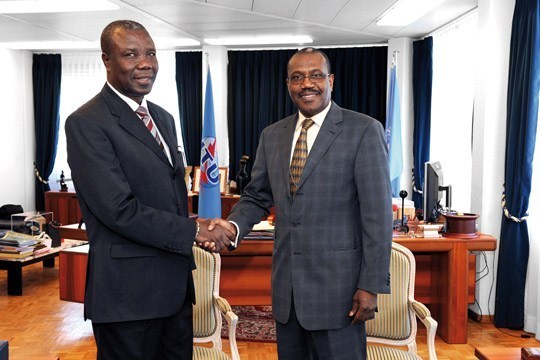
![Bruno Mettling explique la stratégie offensive d’Orange en Afrique [Vidéo] Bruno Mettling explique la stratégie offensive d’Orange en Afrique [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2016/05/Essentials-2020-768x392.jpg)
![Régulation : les conseils de Bruno Mettling (Orange) aux Africains et Camerounais [Vidéo] Régulation : les conseils de Bruno Mettling (Orange) aux Africains et Camerounais [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2016/05/Bruno-Mettling-2-768x444.jpg)


![Cloud Transformation, Reforming Your Business [by Huawei] Cloud Transformation, Reforming Your Business [by Huawei]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2016/05/Zou-Zhilei-President-of-Carrier-Business-Group-Huawei-768x424.png)