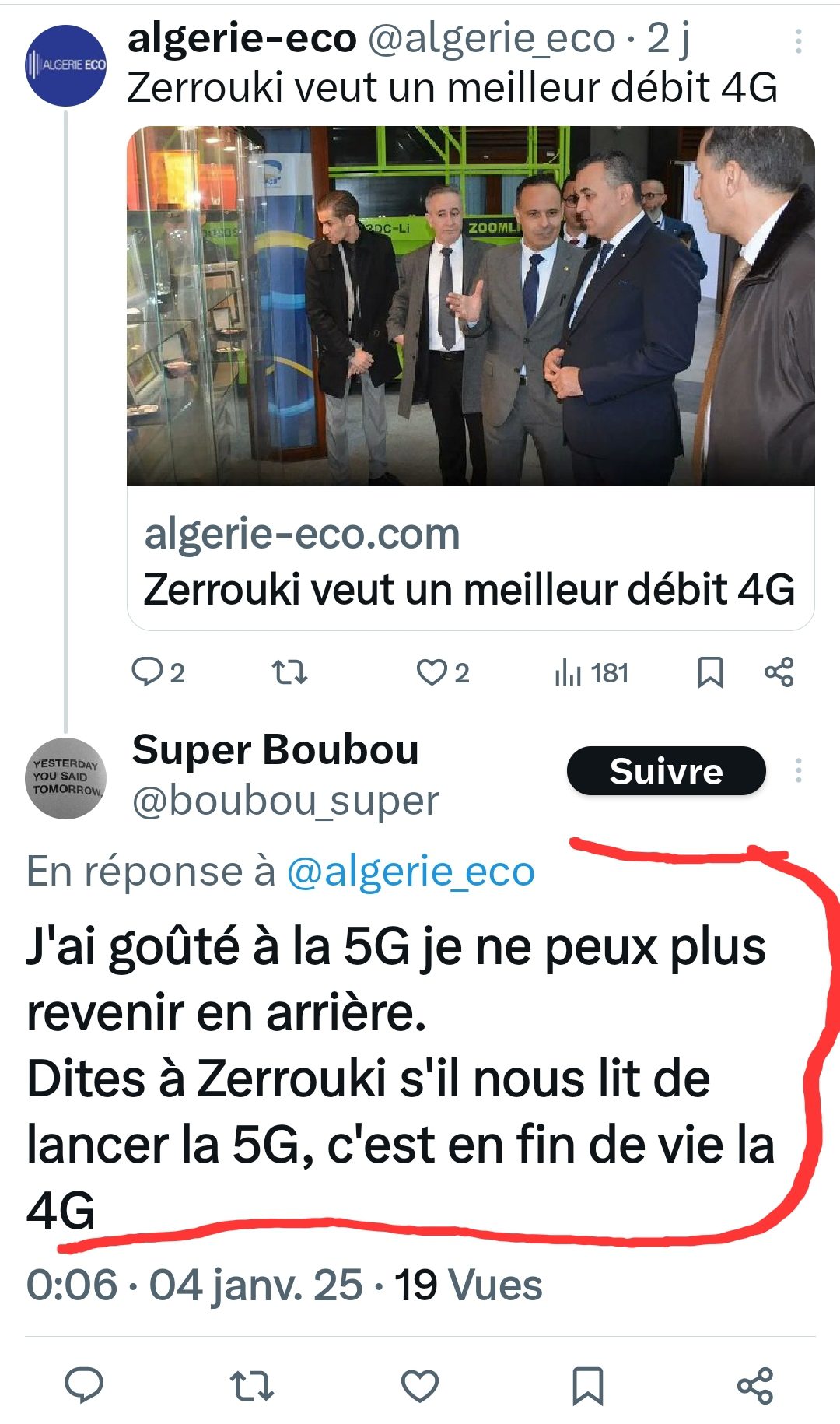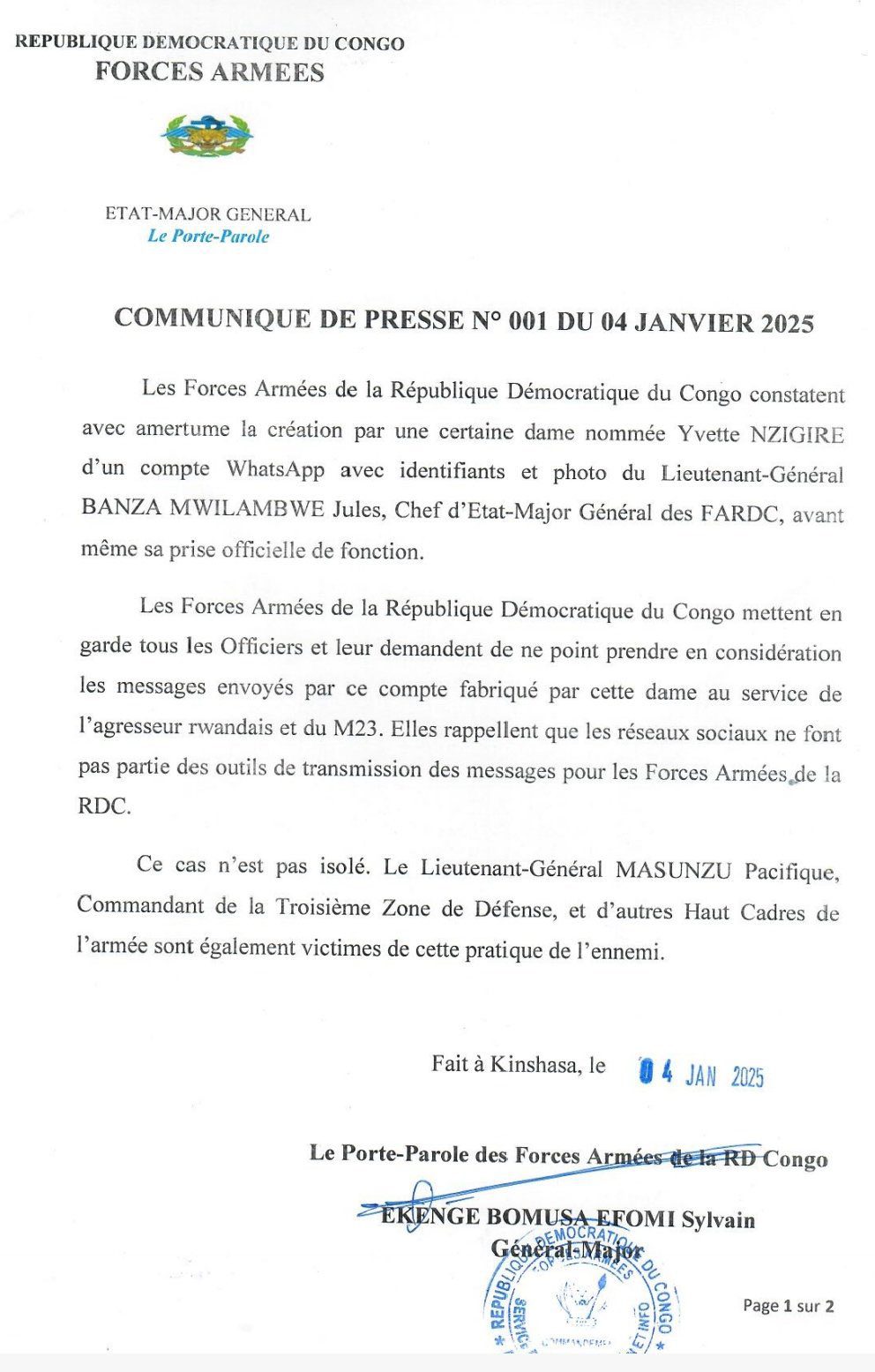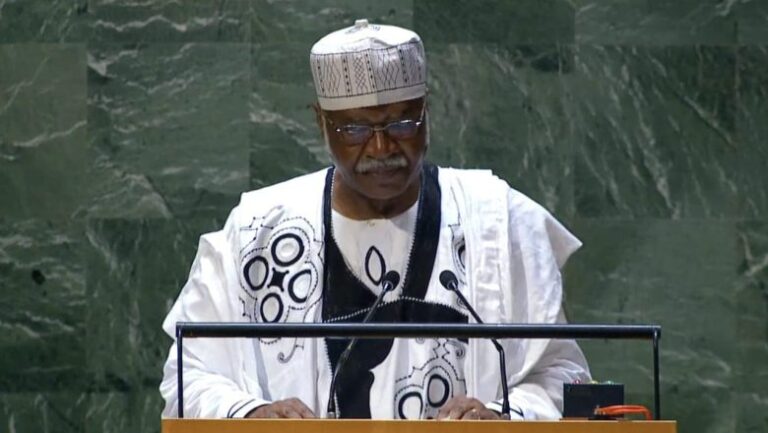[DIGITAL Business Africa] – Airtel Gabon, premier opérateur fixe autorisé. C’est un fait historique. Le président de l’Autorité de Régulation des Communications électroniquess et des Postes (Arcep), Célestin Kadjidja et le directeur général d’Airtel Gabon, Thomas Herbert Gutjahr, ont signé un accord y relatif ce mardi 7 janvier 2025.
Dans le cahier des charges qui est donné à Airtel Gabon, il est mentionné que l’opérateur jouit des droits et obligations pour l’installation et le déploiement d’un réseau FTTH en fibre optique. Airtel Gabon, selon Célestin Kadjidja, président de l’Arcep, devra respecter des conditions strictes d’exploitation afin de garantir une connectivité haut débit, essentielle à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle .
Le DG d’ Airtel Gabon, Thomas Herbert Gutjahr, se réjouit de cet accord qui va permettre à l’entreprise de mieux déployer sa politique sur le terrain. Et de rivaliser avec ses concurrents.
« Avec cette licence, nous intensifions notre engagement à réduire la fracture numérique. Nous pouvons désormais fournir de l’Internet par fibre optique, ce qui était auparavant hors de notre portée. Cela profitera aux particuliers, aux entreprises et contribuera à dynamiser l’économie numérique gabonaise. Nous étions exclus de ce marché, mais aujourd’hui, nous sommes en mesure de rivaliser avec les autres opérateurs », a-t-il dit.
L’ accord apporte aux Gabonais :
1- L’internet haut débit via la fibre optique : Offrant aux entreprises et particuliers une connectivité fiable, performante et à des tarifs compétitifs.
2. Connectivité pour les zones les plus reculées : Déploiement d’innovations technologiques permettant de connecter les localités éloignées et jusque-là enclavées, dans l’objectif d’assurer une véritable inclusion numérique sur tout le territoire.
3. Transport de données par faisceaux hertziens : Fourniture de solutions de connectivité sur mesure pour tout opérateur économique, stimulant ainsi la collaboration et la compétitivité.
Airtel Gabon rejoint ainsi Move Africa Gabon Télécom et GVA Canal+, déjà actifs sur le marché de la fibre optique.
Par Jean Materne Zambo, source : gabonnews.com