L’analyse de l’environnement de gouvernance de Camtel laisse entrevoir des inquiétudes et risques qui interpellent l’opérateur historique sur la nécessité de se réinventer et trouver de nouvelles façons d’innover au plus vite.
Le développement d’une entreprise suppose une bonne connaissance de l’environnement économique dans lequel elle évolue. Il s’agit de tous les facteurs économiques externes qui influencent les habitudes d’achat des consommateurs et des entreprises et qui par conséquent, ont une incidence sur le rendement de l’entreprise.
Dans un contexte concurrentiel, les entreprises qui n’arrivent pas à comprendre les consommateurs et à répondre à leurs besoins, risquent de perdre ces derniers et de voir leurs activités se décliner. Et pour ce faire, il leur faut adopter, dans le cadre de leur politique commerciale, des stratégies et outils marketing leur permettant de développer des produits et/ou services à même de mieux satisfaire le consommateur, afin d’obtenir un avantage durable sur la concurrence.
En ce qui concerne spécifiquement les télécommunications, au vu de l’importance sans cesse croissante de ce secteur pour l’économie dans son ensemble ainsi que de l’âpre concurrence qui y règne, les marchés des TIC dans le monde deviennent de plus en plus compétitifs sur chaque segment : chaque entreprise voulant se tailler une part importante dans le potentiel énorme de ce marché tentaculaire, à travers un marketing stratégique approprié.
Et dans le marché des télécommunications, ce marketing englobe l’ensemble des choix relatifs : à la nature des biens et services proposés par l’entreprise, leur positionnement par rapport aux produits concurrents, leur combinaison en une gamme plus ou moins large, profonde et cohérente, leur différenciation grâce à des marques et à des conditionnements plus ou moins originaux. Il doit également tenir compte des pratiques du marché et de la concurrence, de la réaction prévisible des consommateurs, des contraintes de la réglementation en vigueur, et de la position concurrentielle de l’entreprise avec les atouts et les handicaps dont elle recèle.
C’est ainsi que depuis quelques semaines, on observe à travers une vaste campagne média (presse, réseaux sociaux et même affichage) un grand déploiement de l’opérateur historique des télécommunications, par une nouvelle marque : « Blue ». Ce grand déploiement de Camtel à travers Blue, est en effet un plan de rebranding basé sur les trois titres qui lui ont été octroyées.
Ainsi, le client final devra uniquement voir un seul « visage » : la marque « Blue », qui offrira sur le marché une multitude de produits et de services variés. A travers ce branding, le client ne percevra plus que la marque « Blue » sous toutes ses formes, selon que les produits relèvent du mobile, du fixe ou du transport.
En effet, dans un environnement aussi compétitif que le notre aujourd’hui, lancer un nouveau produit ou service pour une entreprise n’est pas chose évidente. Ce d’autant que, dans le contexte économique actuel, les consommateurs ont la totale liberté de choisir parmi une multitude de produits et une vaste gamme de services professionnels.
Camtel se doit par conséquent, de se réinventer et trouver de nouvelles façons d’innover, pour rattraper le retard accusé face aux autres acteurs du secteur. Avec l’analyse des habitudes de consommation, l’opérateur historique a l’obligation d’être proactif et à l’affût des dernières tendances. C’est ce qui justifie sans aucun doute, le développement de la marque « Blue », pour assurer la commercialisation de ses produits.
Cependant, si une telle campagne peut donner une impression de dynamisme, celle-ci, à l’observation de l’écosystème des télécommunications au Cameroun, peut néanmoins susciter de réelles inquiétudes sur l’efficacité de la stratégie de positionnement de Camtel sur le marché des télécommunications au Cameroun. Rien dans tout ce déploiement n’indique le développement d’un produit différenciant ou alors service innovant, destinés à « porter » la marque « Blue ». Dès lors, cette situation nous pousse à mener une réflexion sur la pertinence et les limites d’un tel déploiement.
· La Pertinence
Il faut rappeler que les marques permettent d’augmenter la valeur de l’entreprise et la reconnaissance des produits ou services offerts auprès des consommateurs, dans des secteurs d’activités parfois extrêmement concurrentiels. Elles permettent au produit commercialisé de se distinguer de la masse et laissent une image positive de l’entreprise lorsque les consommateurs pensent aux produits ou services offerts. Toutes les marques ont une vie. Mais la mise en œuvre de la marque « Blue » demeure assez complexe. Le problème avec « Blue » c’est qu’en l’absence de produit/service innovant, l’on s’interroge sur les véritables enjeux et l’opportunité de cette opération.
Pour être efficace et réussir, il ne s’agit pas de simplement se poser quelques questions générales sur le marché, mais bien d’avoir une connaissance approfondie de celui-ci pour offrir aux consommateurs exactement ce qu’ils recherchent et plus encore. Et c’est là le problème. Camtel a-t-il réellement étudié les besoins de sa clientèle ? Qu’est ce qui est concrètement offert sur le marché ? Quelle est l’innovation qui démarque cette entreprise des autres concurrents ? Quel est son positionnement ?
Bref, on en est à se poser plusieurs questions. Et de manière plus concrète, en nous basant sur les 4 piliers opérationnels du mix marketing : Quel est le produit ou service à mettre sur le marché ? À quel prix le produit ou service devra être vendu ? Quels seront les points de vente / Où sera-t-il vendu ?
A ce jour, nous demeurons sur notre faim et sommes en vérité un peu perdus sur la mise en œuvre de cette marque qui en effet, doit pouvoir nous permettre de comprendre le concept à déployer, le marché à cibler, le positionnement à véhiculer et les moyens pour y arriver.
Quoique l’on en dise et malgré son envergure, le nouveau déploiement de CAMTEL à travers la marque « Blue » présente des limites et ne répond pas vraiment aux attentes du Gouvernement vis-à-vis de l’opérateur historique camerounais. ·
Les limites
Le 12 mars 2020, le gouvernement de la République a octroyé trois conventions de concession à la Cameroon Telecommunications. Ces conventions avaient pour but l’établissement et l’exploitation de réseaux de communications électroniques fixe, mobile et de transport, à couverture nationale ouverts au public. Toute chose visant à renforcer la productivité de l’opérateur historique national, en vue de l’amélioration de l’offre des services de télécommunications électroniques de qualité.
Les trois segments concernés par ces titres portaient sur:
– l’établissement et l’exploitation d’un mobile à couverture nationale ouvert au public, liés aux technologies d’accès 2G, 3G et 4G ;
– l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixes à couverture nationale ouvert au public par des accès filaires ;
– L’établissement et l’exploitation d’un réseau de transport de communications électroniques. Selon les experts du Minpostel, pour l’exploitation de ces trois licences, le gouvernement camerounais avait exigé de l’opérateur historique la mise en place d’un Continuum Organisationnel Ouvert, qui intègre à très court terme la création des unités de gestion en fonction des titres d’exploitation octroyés, afin d’aboutir à une séparation fonctionnelle mature.
La création de ces unités de gestion, vise en effet à une plus grande transparence dans L’analyse de l’environnement de gouvernance de Camtel laisse entrevoir des inquiétudes et risques qui interpellent l’opérateur historique sur la nécessité de se réinventer et trouver de nouvelles façons d’innover au plus vite.
La gestion régulée du segment de transport.
Il faut souligner que Camtel est actuellement un opérateur verticalement intégré en vertu des trois titres d’exploitation qui lui ont été concédés par le gouvernement. Le titre d’exploitation de transport accorde à l’opérateur historique un monopole naturel dans le déploiement et l’exploitation des liaisons de communication interurbaines, des câbles sous-marins et des liaisons satellitaires et par conséquent, Camtel est le grossiste de capacités Internet des autres opérateurs du marché.
Cependant, conformément aux meilleures pratiques, un monopole qui possède et exploite une infrastructure essentielle que d’autres opérateurs doivent utiliser pour fournir des services à leurs clients, doit donner des gages d’un accès équitable et d’une tarification transparente, afin d’éviter les abus de position dominante sur le marché.
A date, les attentes des utilisateurs camerounais ne sont pas encore satisfaites et les questionnements au sein de la population demeurent, en raison de l’absence de visibilité sur les trois unités de gestion ainsi que sur le marché, des services et produits issus de ces trois unités. Par ailleurs, l’opinion attend toujours que le modèle économique prescrit soit traduit en actes
Ainsi, en ce qui concerne la mise en place des unités de gestion, le gouvernement attendait de Camtel :
L’élaboration d’un plan global de séparation portant sur la séparation des équipements et des actifs de Camtel tenant compte des objectifs stratégiques du marché et du cadre réglementaire en vigueur. – La préparation des contrats entre les Unités de Production séparées et incluant les SLA (Service Level Agreement) fixant les modes de rémunération des personnels et déterminant les interfaces, les coûts/prix des services entre les Unités de Production.
– L’établissement des procédures de la demande/livraison des services. S’agissant particulièrement des produits et services, les attentes concernent :
– La disponibilité d’un réseau mobile et des services associés.
– La disponibilité d’une offre fixe, et des services associés.
– Et la disponibilité d’une offre transparente destinée aux acteurs du segment du transport. Le seul produit présenté dans le cadre du lancement de « Blue », le WWTTX, demeure un produit destiné à une certaine catégorie de la population.
De toute évidence, les éléments requis ne sont encore disponibles, puisque visiblement le lancement du mobile qui aurait dû constituer le produit phare du déploiement de « Blue », tarde encore. Nous l’avons tous suivi, ce lancement a plusieurs fois été annulé par le Ministre de tutelle. Et selon des indiscrétions des responsables de Camtel, le Cabinet qui avait été choisi pour accompagner l’entreprise dans la réforme prescrite aurait claqué la porte. Ce qui met en doute la capacité de Camtel à conduire la réforme organisationnelle prescrite par le gouvernement et qui devrait la conduire vers plus de productivité et de compétitivité. Cette situation à notre avis engendre d’importants risques pour l’avenir de Camtel et au-delà, pour le développement du marché des communications électroniques au Cameroun.
· Qu’est ce qui bloque donc chez Camtel ?
On le voit bien, la nouvelle stratégie commerciale de Camtel adoptée depuis l’année dernière (Custom Centricity) et dont l’un des axes apparaît être le déploiement de la nouvelle marque bute devant l’absence de produit(s) d’ « attaque », permettant à l’opérateur public des communications électroniques de se positionner sur le marché camerounais. S’agirait-il de mauvaise volonté ou alors d’incompétence ?
En d’autres termes, Camtel refuserait-il de mettre en œuvre les prescriptions du Gouvernement ? Ou son management serait-il incapable d’impulser la réforme ? Ou alors seraient ce des difficultés dans la gouvernance ?
Il y’a quelques jours la Commission Technique de Réhabilitation des entreprises et secteur public et parapublic a lancé un appel d’offres international visant le recrutement d’un consultant, pour une étude diagnostique de la structure. « Sur la base d’une évaluation de la situation socio-économique et financière de Camtel dans toutes ses dimensions, il s’agira pour le consultant de faire un état des lieux complet de la situation de Camtel dans son secteur d’activités ; cerner ses difficultés et analyser leurs causes endogènes et exogènes sur les plans institutionnel technique, organisationnel, opérationnel, financier, commercial etc. ; identifier ses forces et ses faiblesses ; présenter le marché de Camtel, et sa situation concurrentielle ; comparer les performances et la stratégie de Camtel à un benchmark d’entreprise comparables en Afrique », précise l’appel d’offres.
Comment comprendre que cette étude soit initiée après le lancement de la marque « Blue » ? Ce qui nous amène à nous interroger sur la maturité du business model que cette entreprise a mis en œuvre dans le cadre de son nouveau déploiement commercial.
Toutes choses qui par ailleurs devraient susciter de vives inquiétudes pour les observateurs avertis de l’écosystème des communications électroniques au Cameroun.
Sans réforme permettant de favoriser la mise en œuvre idoine des conventions de concession octroyées à Camtel, sans produit différenciant ou service novateur lui permettant de se positionner sur le marché des communications électroniques, l’évolution actuelle de Camtel comporte de gros risques et pousse à réfléchir sur ce que peut être l’avenir de l’opérateur historique dans ces conditions.
Mohamadou Bamba, Expert IT
·Les Risques
Les licences accordées à Camtel visaient à en faire un opérateur moderne et performant des télécommunications au Cameroun, à travers le renforcement de sa productivité et de sa compétitivité en vue de l’amélioration de sa rentabilité financière.
Aujourd’hui et de manière globale, la poursuite de la réforme dans l’environnement actuel de gouvernance de Camtel laisse entrevoir des inquiétudes et des risques au rang desquels :
– la confusion de la globalisation de la marque « Blue » à tous les services offerts par Camtel, quel que soit le segment de marché considéré (fixe, mobile ou transport) ;
– l’absence de transparence entre la fourniture des services WTTx et les services mobiles (LTE) de Camtel ;
– une perte inexorable des recettes prévisionnelles de plusieurs milliards attendues du mobile, en raison d’un lancement tardif et non contrôlé ;
– la capacité pour Camtel à soutenir financièrement l’extension de son réseau mobile sur fonds propres ;
– une contreperformance de Camtel qui militerait en faveur du questionnement de sa capacité à pourvoir gérer seul le segment de transport ;
– le risque de geler certains projets clés du segment de transport.
L’endettement élevé de l’entreprise, le désengagement de l’État à garantir les emprunts de Camtel, les difficultés de trésorerie que traverse l’opérateur historique, ne militent pas en faveur de la mise en place d’une stratégie interne de financement de la réforme.
L’un des plus grands risques aujourd’hui créés par la situation de Camtel est celui de l’achèvement des infrastructures de la prochaine CAN.
Au vu de ce qui précède, de quoi est fait l’avenir de Camtel ?
Camtel doit rapidement se transformer en un opérateur compétitif, efficace sur un marché largement dominé par les filiales de multinationales. Pour y arriver, les approches managériales de l’équipe dirigeante de Camtel qui semblent ne pas prendre en compte les mécanismes de transformation qui ont été clairement définis non seulement par le Cabinet d’experts chargé de l’accompagnement de l’entreprise dans sa réforme, mais également par la tutelle.
Les stratégies modernes de marketing des services sortent de leurs frontières traditionnelles centrées sur les clients, pour intégrer les modes de pilotage des équipes chargées de leur mise en œuvre.
C’est ainsi que déjà, dans la 2e édition de l’ouvrage « Du management au marketing des services », publié chez Dunod en 2011 par Charles Ditandy et Benoît Meyronin, le marketing des services est défini comme suit : « C’est prendre soin de ses équipes, pour qu’elles prennent soin des clients. C’est mettre ainsi en œuvre une symétrie des attentions ».
Cette intégration d’une culture client et d’une culture managériale permet d’ancrer dans la durée une culture de service, laquelle s’incarne tout à la fois dans le souci de ses clients et de ses ressources humaines. C’est donc, pour finir, une posture managériale.
Aussi à notre avis, la réforme managériale doit accompagner la réforme organisationnelle de Camtel, si le gouvernement veut assurer un avenir à l’opérateur historique des télécommunications au Cameroun.
Par Mohamadou Bamba, Expert IT



![Le Top 10 des hommes les plus riches du monde [Technologie] Le Top 10 des hommes les plus riches du monde [Technologie]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2021/10/Richest-Billionnaires-768x500.jpeg)
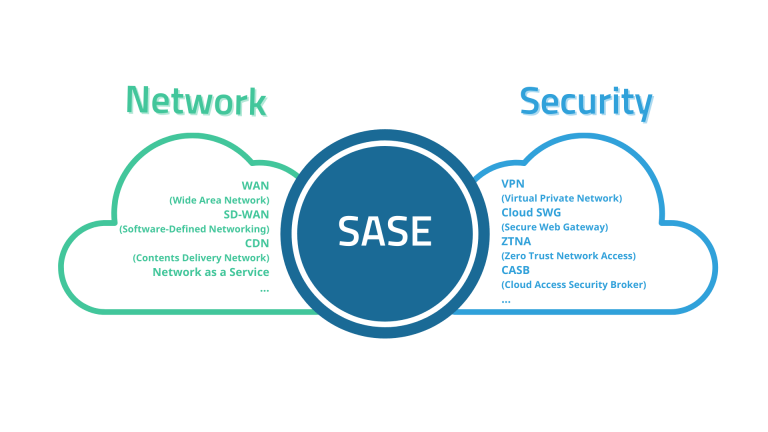

![Congo Brazza : Voici le livre Blanc de l’Arpce sur les télécoms et l’économie numérique [Document] Congo Brazza : Voici le livre Blanc de l’Arpce sur les télécoms et l’économie numérique [Document]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2021/10/Livre-Blanc-ARPCE-768x441.jpeg)


![James Gabriel Claude [GVG] : « TransFin renforce les capacités des gouvernements et des banques centrales en matière d’interopérabilité » James Gabriel Claude [GVG] : « TransFin renforce les capacités des gouvernements et des banques centrales en matière d’interopérabilité »](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2021/10/James-with-TransFin-logo-768x512.png)





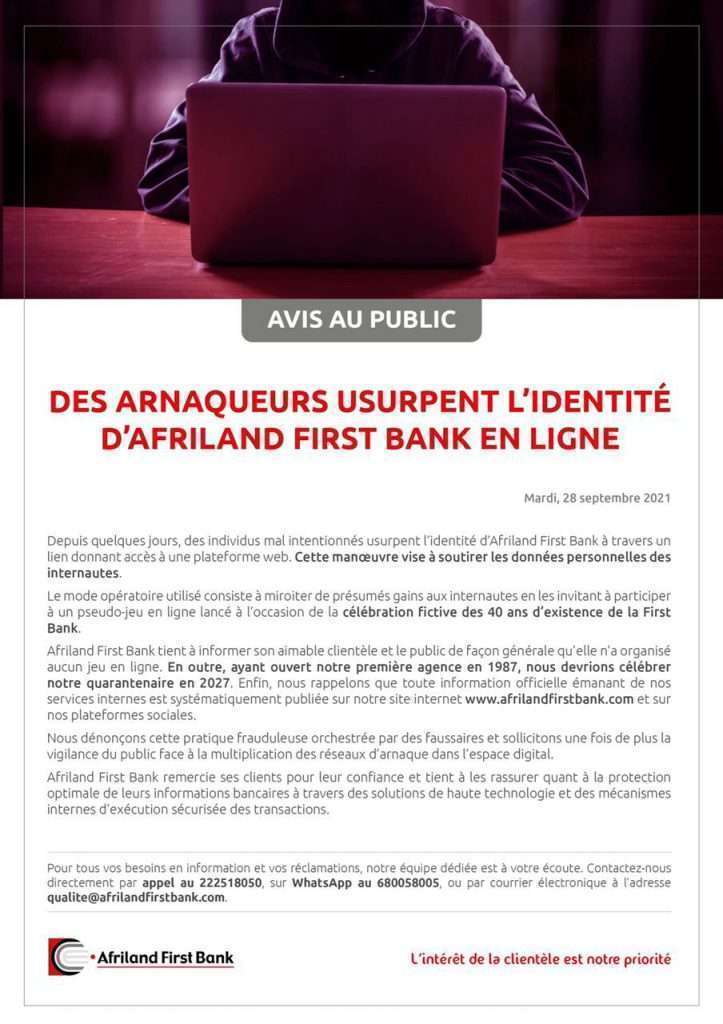











![Dr Hippolyte Fofack [Afreximbank] : « Le FEDA est notre réponse à la problématique des jeunes entrepreneurs du numérique qui manquent des financements » Dr Hippolyte Fofack [Afreximbank] : « Le FEDA est notre réponse à la problématique des jeunes entrepreneurs du numérique qui manquent des financements »](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2021/09/Dr-Hippolyte-Fofack-Afreximbank-1.jpeg)


