[DIGITAL Business Africa] – Selon Ericsson, le nombre d’abonnements mobiles 5G devrait dépasser les 580 millions d’ici la fin 2021, grâce à un million de nouveaux abonnements mobiles 5G par jour. En effet, les abonnements 5G avec un appareil compatible 5G ont augmenté de 70 millions au cours du premier trimestre 2021.
Autre observation de l’étude, la 5G est en passe de devenir la génération mobile la plus rapidement adoptée de l’histoire, avec une augmentation du nombre d’abonnements d’environ un million par jour. La Chine, l’Amérique du Nord et les marchés du Conseil de coopération du Golfe sont en tête pour le nombre d’abonnés, tandis que l’Europe connaît un démarrage lent.
Ces prévisions, qui figurent dans la 20e édition du Mobility Report d’Ericsson, renforcent l’idée que la 5G deviendra la génération mobile la plus rapidement adoptée de tous les temps, avec 3,5 milliards d’abonnements 5G et une couverture de 60 % de la population en 5G d’ici à la fin 2026.
Toutefois, le rythme d’adoption varie considérablement selon les régions. L’Europe connaît un démarrage plus lent et a continué à se laisser distancer par la Chine, les États-Unis, la Corée, le Japon et les marchés du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en ce qui concerne le rythme de déploiement.
La 5G devrait dépasser le milliard d’abonnements deux ans avant le calendrier de la 4G/LTE pour la même étape. Parmi les principaux facteurs à l’origine de ce résultat, citons l’engagement plus précoce de la Chine en faveur de la 5G, ainsi que la disponibilité plus précoce et l’accessibilité financière croissante des appareils 5G commerciaux. Plus de 300 modèles de smartphones 5G ont déjà été annoncés ou lancés commercialement.
Cette dynamique commerciale de la 5G devrait se poursuivre dans les années à venir, stimulée par le rôle accru de la connectivité comme élément clé de la reprise économique post-COVID-19.
L’Asie du Nord-Est devrait représenter la plus grande part des abonnements 5G d’ici 2026, avec 1,4 milliard d’abonnements 5G. Alors que les marchés d’Amérique du Nord et du CCG devraient représenter la plus forte pénétration des abonnements 5G, avec des abonnements mobiles 5G représentant respectivement 84 % et 73 % de tous les abonnements mobiles régionaux.
Fredrik Jejdling, Vice-Président exécutif et directeur des Réseaux d’Ericsson, déclare : “Cette 20ème édition historique du Mobility Report d’Ericsson montre que nous sommes dans une nouvelle phase de la 5G, avec une accélération des déploiements et une expansion de la couverture sur les marchés pionniers tels que la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud. Le moment est venu pour les cas d’usage avancés de commencer à se matérialiser et de tenir les promesses de la 5G. Les entreprises et les sociétés se préparent également à un monde post-pandémique, la digitalisation fondée sur la 5G jouant un rôle essentiel.”
Les smartphones et la vidéo sont les moteurs du trafic de données mobiles
Le trafic de données continue de croître d’année en année. Un exaoctet (EB) comprend 1 000 000 000 (1 milliard) de gigaoctets (GB). Le trafic mondial de données mobiles – à l’exclusion du trafic généré par l’accès sans fil fixe (FWA) – a dépassé 49 EB par mois à la fin de 2020 et devrait être multiplié par un facteur proche de 5 pour atteindre 237 EB par mois en 2026. Les smartphones, qui acheminent actuellement 95 % de ce trafic, consomment également plus de données que jamais. À l’échelle mondiale, l’utilisation moyenne par smartphone dépasse désormais 10 Go/mois et devrait atteindre 35 Go/mois d’ici à la fin de 2026.
Les fournisseurs de services de communication 5G à l’avant-garde de l’adoption de l’accès fixe sans fil
La pandémie de COVID-19 accélère la digitalisation, tout en augmentant l’importance et la nécessité d’une connectivité mobile haut débit fiable. Selon le dernier rapport, près de neuf fournisseurs de services de communication (FSC) sur dix qui ont lancé la 5G disposent également d’une offre d’accès sans fil fixe (FWA) (4G et/ou 5G), même sur les marchés où la pénétration de la fibre optique est élevée. Cela est nécessaire pour faire face à l’augmentation du trafic FWA, qui, selon le rapport, devrait être multiplié par sept pour atteindre 64 exaoctets en 2026.
L’IoT massif en plein essor
Les technologies IoT massives NB-IoT et les connexions Cat-M devraient augmenter de près de 80 % en 2021, pour atteindre près de 330 millions de connexions. En 2026, ces technologies devraient représenter 46 % de toutes les connexions IoT cellulaires.
Focus sur le conseil de coopération du Golfe
Le rapport présente de nouvelles statistiques pour les marchés du CCG où les initiatives digitales parrainées par les gouvernements accélèrent à la fois l’innovation technologique et l’adoption prévue de la 5G. En 2019, les marchés du CCG ont été parmi les premiers au monde à lancer des services 5G commerciaux. D’ici 2026, ils devraient gérer un total de 62 millions d’abonnements 5G, ce qui représente la deuxième plus forte pénétration au niveau mondial.
Cette édition du Mobility Report d’Ericsson comprend aussi quatre articles :
– T-Mobile poursuit une stratégie multi-bande
– Les entreprises construisent la 5G sur la base du WAN sans fil
– L’IA : améliorer l’expérience client dans un monde 5G complexe
– Planification de la couverture intra-bâtiment pour la 5G : des règles empiriques aux statistiques et à l’IA
A Propos d’Ericsson
Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de capturer tout le potentiel offert par la connectivité. Son portefeuille couvrant les réseaux, les services digitaux, les services managés et les activités émergentes est conçu pour permettre à ses clients d’être plus performants, de passer à l’ère digitale et de trouver de nouvelles sources de revenus. Ericsson estime que ses investissements dans l’innovation ont permis à des milliards de personnes à travers le monde de bénéficier des avantages de la téléphonie et du haut débit mobile. L’action Ericsson est cotée au Nasdaq Stockholm et au NASDAQ à New York.
Source : Communiqué Ericsson




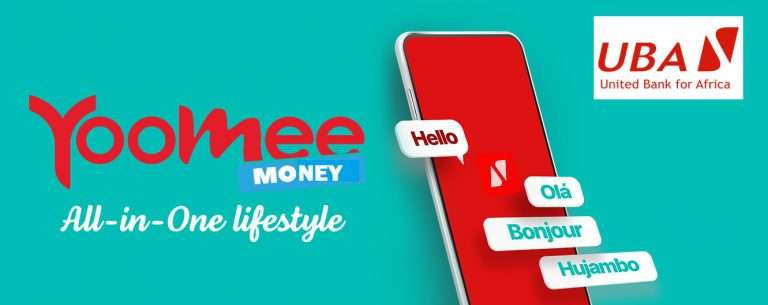












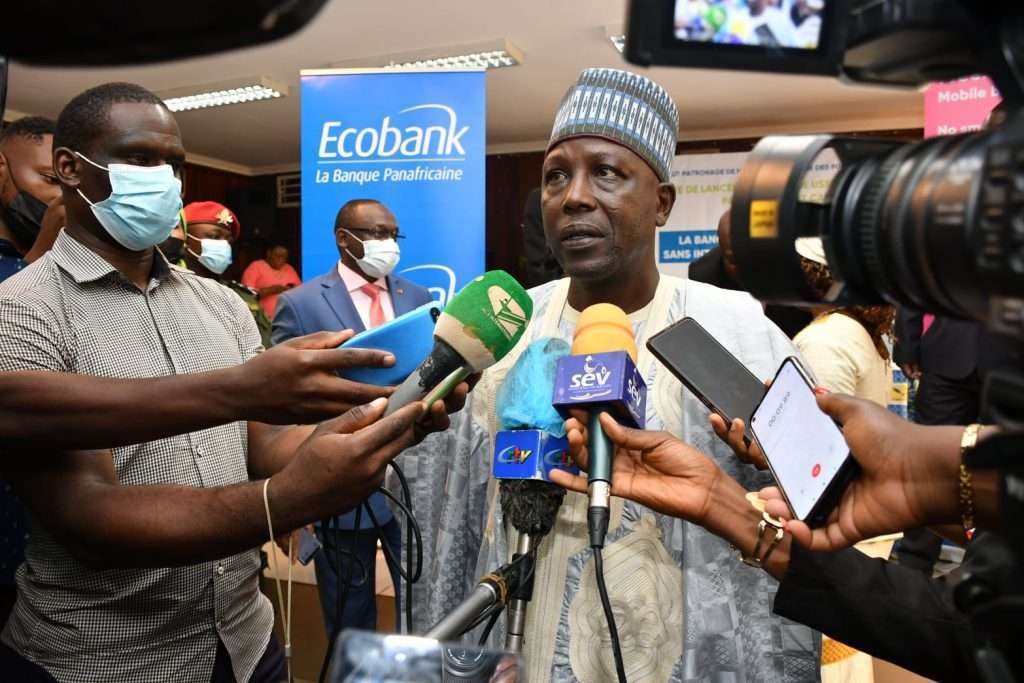

![Gwendoline ABUNAW [ADG d’Ecobank Cameroun] : « J’aime l’innovation. Je ne suis pas opposée aux cryptomonnaies. Mais… » Gwendoline ABUNAW [ADG d’Ecobank Cameroun] : « J’aime l’innovation. Je ne suis pas opposée aux cryptomonnaies. Mais… »](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2021/06/Gwendoline-Abunaw-Ok-768x483.jpg)










