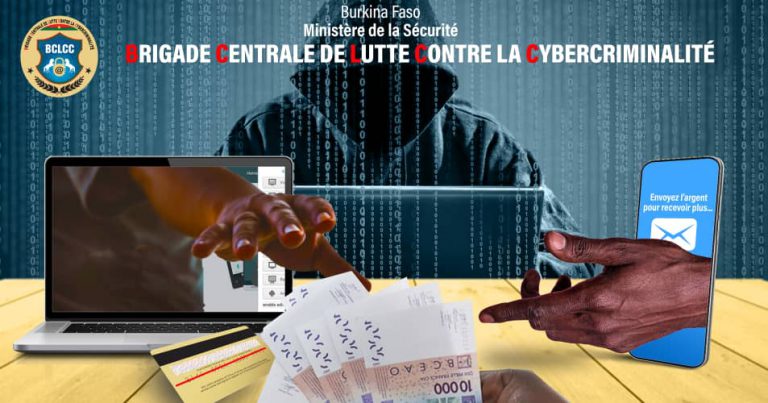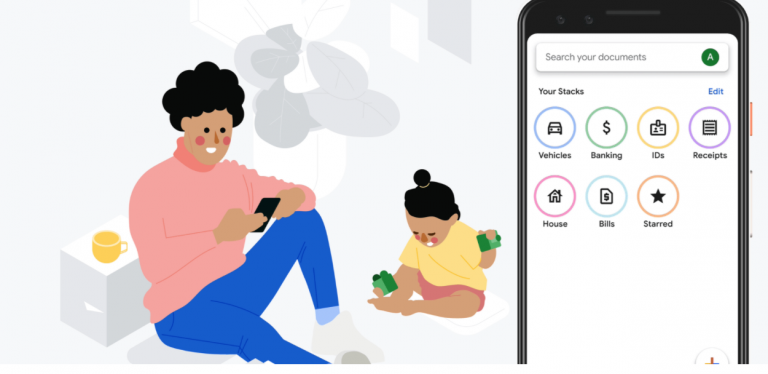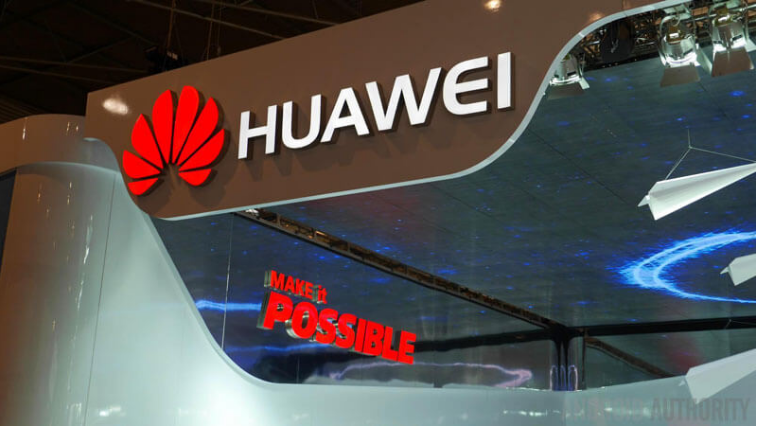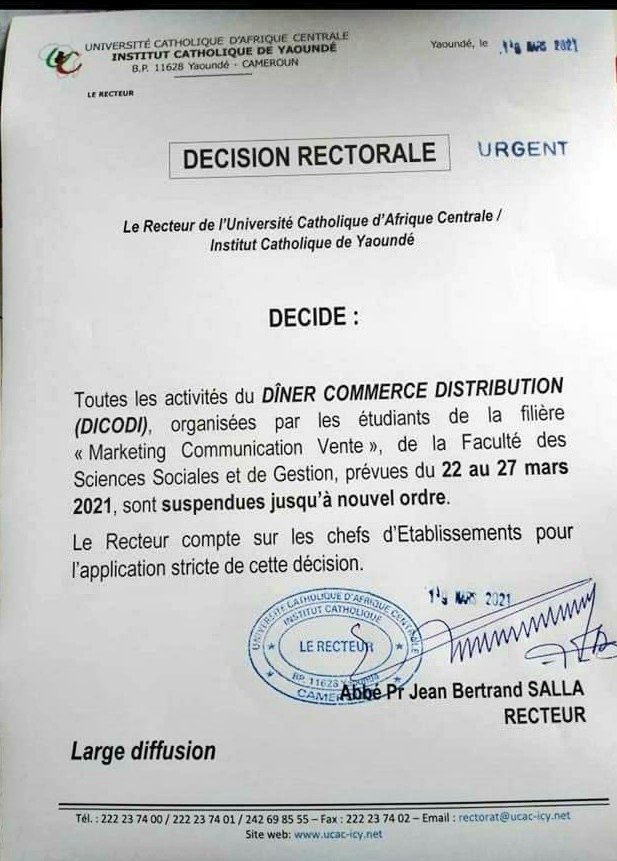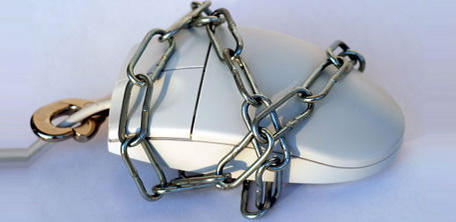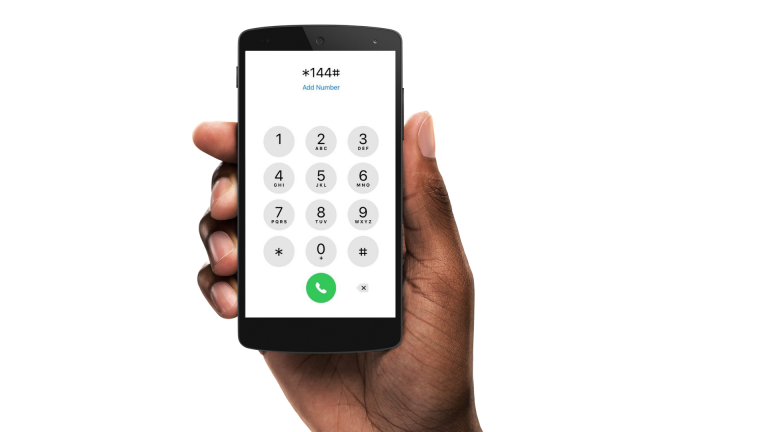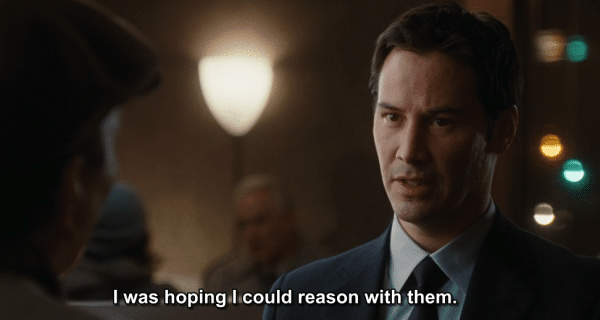[Digital Business Africa] – Huawei a publié aujourd’hui son rapport annuel pour l’année 2020. Malgré le ralentissement de la croissance, les performances commerciales de l’entreprise ont été conformes aux prévisions. Le chiffre d’affaires de Huawei en 2020 s’est élevé à 891,4 milliards de yuans (136,7 milliards de dollars), soit une hausse de 3,8 % par rapport à l’année précédente, et son bénéfice net a atteint 64,6 milliards de yuans (9,9 milliards de dollars), soit une hausse de 3,2 % par rapport à l’année précédente.
Malgré les difficultés opérationnelles engendrées par les sanctions américaines en 2019 et 2020, Huawei a sollicité le cabinet KPMG pour auditer de manière indépendante et objective ses états financiers. Le rapport délivré par KPMG est indépendant et n’a pas été modifié par Huawei. Quelles que soient les circonstances, Huawei poursuivra sa politique de transparence en communiquant des données opérationnelles aux gouvernements, aux clients, aux fournisseurs, aux employés et aux partenaires.
En 2020, le secteur des télécommunications de Huawei a continué à assurer le fonctionnement stable de plus de 1.500 réseaux dans plus de 170 pays et régions, ce qui a contribué à favoriser le télétravail, l’apprentissage en ligne et le e-commerce pendant les confinements décrétés à la suite de la Covid-19.
En collaboration avec les opérateurs du monde entier, l’entreprise a contribué à offrir une expérience connectée supérieure et a fait avancer plus de 3.000 projets d’innovation 5G dans plus de 20 secteurs tels que les mines de charbon, la production d’acier, les ports et les usines.
Au cours de l’année écoulée, le secteur des services aux entreprises de Huawei a intensifié ses efforts pour développer des solutions innovantes pour différentes industries basées sur des scénarios et créer un écosystème numérique qui s’appuie sur un processus créatif mutuellement bénéfique.
Durant la pandémie, Huawei a fourni une expertise technique et des solutions qui se sont avérées vitales pour lutter contre le virus. Grâce à une solution de diagnostic assisté par l’IA basée sur le Huawei Cloud, les hôpitaux du monde entier ont pu réduire la charge sur leurs infrastructures médicales.
Huawei a également collaboré avec des partenaires pour lancer des plateformes d’apprentissage en ligne basées sur le cloud pour plus de 50 millions d’élèves du primaire et du secondaire.
HarmonyOS
Avec le déploiement de HarmonyOS et de l’écosystème Huawei Mobile Services (HMS), le secteur grand public de Huawei a progressé grâce à sa stratégie Seamless AI Life (« 1 + 8 + N ») pour offrir aux consommateurs une expérience intelligente sur tous les appareils et dans tous les scénarios, en privilégiant le bureau intelligent, la forme et la santé, la maison connectée, le transport facilité et le divertissement.
« Au cours de l’année écoulée, nous avons tenu bon face à l’adversité », a déclaré Ken Hu, président en exercice de Huawei. « Nous avons continué à innover pour créer de la valeur pour nos clients, pour aider à lutter contre la pandémie, et pour soutenir à la fois la reprise économique et le progrès social dans le monde entier. Nous avons également profité de cette occasion pour améliorer davantage nos opérations, ce qui a conduit à des performances largement conformes aux prévisions.
Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires pour soutenir le progrès social, la croissance économique et le développement durable. »
Tous les états financiers du rapport annuel 2020 ont été vérifiés de manière indépendante par KPMG, cabinet comptable international parmi les quatre plus grands. Pour télécharger le rapport annuel 2020, cliquez ici.
Par Digital Business Africa