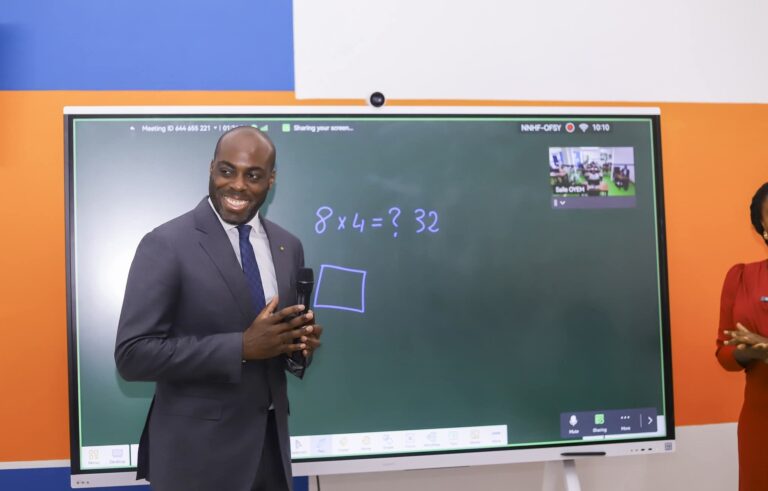[Digital Business Africa]- Le Cameroun accélère sa transition vers une souveraineté numérique assumée. À l’occasion des Journées « Cloud » organisées par Cameroon Telecommunications (CAMTEL) au Data Center de Zamengoe, autorités publiques et acteurs du numérique ont posé les bases d’un repositionnement stratégique : mieux encadrer l’exploitation des données, réduire la dépendance aux clouds étrangers et structurer un écosystème local conforme aux nouvelles exigences réglementaires.
Les données, nouvel enjeu de compétitivité et de souveraineté
Dans un contexte de généralisation du cloud, de l’intelligence artificielle et des services numériques, les données sont devenues un actif stratégique. Elles conditionnent la performance des entreprises, la sécurité des États et la capacité d’innovation des économies.
Or, comme dans de nombreux pays africains, une part significative des données camerounaises est encore hébergée hors du continent. Cette situation expose les organisations locales à des risques juridiques et stratégiques, notamment face à des législations extraterritoriales comme le Cloud Act américain.
Pour camtel, l’objectif est désormais clair : reprendre la maîtrise juridique, technique et économique des données nationales.
Une nouvelle loi pour structurer le marché
La loi n°2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel constitue le socle de cette stratégie. Elle modernise en profondeur le cadre réglementaire camerounais et rapproche le pays des standards internationaux, notamment du RGPD européen.
Le texte impose aux entreprises, administrations et plateformes numériques des obligations renforcées : base légale des traitements, transparence vis-à-vis des usagers, sécurité des systèmes d’information et gouvernance interne des données. Les sanctions prévues, pouvant atteindre un milliard de FCFA, traduisent la volonté des pouvoirs publics de rendre la conformité effective.
Cloud, localisation et nouveaux arbitrages
L’un des points les plus sensibles concerne les transferts internationaux de données. La réglementation camerounaise encadre désormais strictement les flux transfrontaliers et encourage l’hébergement local, en particulier pour les données sensibles liées à la santé, aux finances publiques, à la biométrie ou aux télécommunications.
Pour les entreprises utilisant des solutions cloud internationales, ces exigences impliquent de nouveaux arbitrages : relocalisation partielle des données, renégociation des contrats, recours à des data centers locaux ou à des offres dites de « cloud souverain ».
Un mouvement qui pourrait, à terme, stimuler l’investissement dans les infrastructures numériques nationales.
Cyber sécurité : un catalyseur de la réforme
La montée en puissance de la réglementation intervient dans un contexte marqué par plusieurs incidents cyber majeurs au Cameroun. Attaques par ransomware, fuites de données sensibles et indisponibilités de services ont mis en évidence les faiblesses de nombreuses organisations.
La loi introduit désormais l’obligation de notifier les violations de données, renforçant la pression sur les entreprises pour investir dans la cybersécurité, la formation des équipes et la gestion des risques numériques.
Une autorité de régulation très attendue
La création d’une Autorité nationale de protection des données, indépendante, constitue une pièce maîtresse du dispositif. Chargée d’autoriser, de contrôler et de sanctionner, elle jouera un rôle clé dans l’application effective de la loi et la crédibilité du cadre réglementaire.
Pour les acteurs du marché, la question des moyens, de l’indépendance et de la capacité opérationnelle de cette autorité sera déterminante pour éviter une insécurité juridique.
Conformité : contrainte ou opportunité business ?
Si la mise en conformité représente un coût à court terme, elle est aussi perçue comme une opportunité de structuration du marché. Développement de data centers locaux, services de conformité, cyber sécurité managée, cloud souverain : autant de segments susceptibles de bénéficier de la nouvelle donne réglementaire.
Pour les autorités comme pour les opérateurs, l’enjeu est de transformer la contrainte réglementaire en levier de compétitivité numérique.
Un virage stratégique à confirmer
Avec cette réforme, le Cameroun affiche une volonté politique forte : faire des données un pilier de sa stratégie digitale et économique. Le cadre juridique est posé, les infrastructures commencent à suivre, mais la réussite dépendra de l’exécution, de la coordination public-privé et de la capacité du marché à s’adapter.
Pour le Cameroun, la souveraineté des données n’est plus un concept théorique. Elle deviant un chantier structurant du digital business national.
Par Digital Business Africa




![Récupérer l’argent d’un mort de son compte MTN Mobile Money : Alain Nono explique comment [Vidéo] Récupérer l’argent d’un mort de son compte MTN Mobile Money : Alain Nono explique comment [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2019/03/maxresdefault-1-768x432.jpg)
![Récupérer l’argent d’un mort de son compte MTN Mobile Money : Alain Nono explique comment [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2019/03/Alain-Nono-1024x575.jpg)

![Pauline Tsafack : « Il faudra évaluer et recadrer le plan stratégique Cameroun numérique 2020 » [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2019/03/Pauline-Tsafack-1024x572.jpg)

![Jean-Jacques Massima-Landji : « Les paiements électroniques vont poser un problème déontologique » [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2019/03/Jean-Jacques-Massima-Landji-1024x572.jpg)
![Valentin Mbozo’o explique la future interopérabilité des paiements mobiles en zone F.Cfa [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2018/10/Valentin-Mbozoo-DG-du-Gimac-1024x610.jpg)


![Patrick Kengne [Wouri TV] : « 20% de nos visiteurs mobiles sur YouTube viennent du Cameroun » [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2019/03/Patrick-kengne-1024x564.jpg)
![Beaugas – Orain DJOYUM présente Digital Business Africa, la plateforme web d’infos stratégiques sur le numérique [Vidéo]](https://www.digitalbusiness.africa/wp-content/uploads/2019/03/Beaugas-Orain-Djoyum-1024x530.jpg)